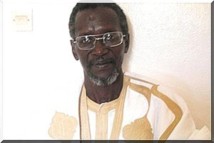
Le débat sur l’appartenance culturelle de la Mauritanie est récurrent, mais, malheureusement, souvent teinté de passion et de sentimentalisme.
Le traitement le plus récent de ce thème, est l’analyse pondérée faite par Monsieur Oiga Abdoulaye, Ancien Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale intitulée : « Contribution au rétablissement de la vérité sur le peuplement historique de la Mauritanie ».
Il soutient notamment que : « L’une des conclusions qu’on peut tirer de son analyse, est que le peuple mauritanien, est un peuple métissé et que c’est dans le métissage, qu’il trouvera son salut ». Pour illustrer ce métissage, il donne quelques exemples significatifs :
-Les Mechdouf et les Oulad M’Bareck, sont fortement métissés avec les Soninkés, les Fulani, et les Bambaras ;
-Les Laghlal, le sont avec les Soninkés ;
-La célèbre famille des Cheikh :
Cheikh Mohamed Fadel, Cheikh El Hadrami, Cheikh Saad Bouh, Cheikh Sidi Bouya, ont pour mère Khadijetou, fille de Boubacar Bal, lui-même, fils du célèbre marabout Souleymane Bal.
« C’est Souleymane Bal, qui combattait les tribus maures, qui imposaient au Fouta, le paiement d’un tribut, appelé par les gens du Fouta, Moudo Horma, jusqu’à sa suppression… »
-La famille de Ehel Meyda, descendrait de Koli Tengella.
-La tribu Degjmolle, serait d’origine Foulbé Jaawbé, devenue maure par assimilation.
« Par ailleurs, poursuit Mr Oiga, les cités historiques telles que Oualata, Chinguitti, Tichit, ont d’abord été habitées par les Soninkés. « Chinguitti signifie en Soninké : (Sii N’Guede), c'est-à-dire, le puits du cheval »
Il soutient, que sa mosquée qui fait 16 à 17 mètres de hauteur, et qui constitue, la fierté des gens du Bilad Chinguitti, a été construite par un Soninké, du nom de Namori Camara ; en 620, après le prophète Mohamed (PSL). Il y fut imam, son nom était écrit sur le mur de la mosquée.
La ville d’Oualata s’appelait Bouri, c'est-à-dire des hangars, en Soninké. Cette cité historique, a changé de nom pour être Djoulata, à cause de son activité commerciale, puis Djoulata a été déformé pour devenir Oualata. Par consacrer cette réalité métissée, Mr Oiga, propose au peuple mauritanien, dans le cadre d’un référendum, d’adopter le nom de Bilad El Chinguitt, pour la Mauritanie.
(Il appartient donc aux mauritaniens d’instaurer un débat apaisé autour de cette question). Le métissage du peuple mauritanien, ne se situe pas uniquement au niveau interne de ses tribus et ethnies, il est transfrontalier. Il est illustré par de nombreux cas historiques, dont, entre autres, l’union de Diombott M’Bodj, reine du Oualo, avec l’Emir du Trarza.
Dans « les Tribus Maures et l’Islam (1920), Paul Marty, soutient que le Chamana est aujourd’hui à peu près exclusivement peuplé et cultivé par les Toucouleurs et les Haratins-Maures.
Ces derniers, presque sédentaires, quoique continuant à habiter la tente, ont leurs campements établis ordinairement à la limite de la région sablonneuse ».
Il soutient que d’autres races habitaient le Chamana dans le passé :
-les Ouolofs :
Probablement, au Moyen-âge, ils étaient installés vraisemblablement beaucoup plus au Nord ; mais reculèrent peu à peu vers le Fleuve, sous la pression des tribus peulh Bababé, et les tribus berbères maures.
-les sérères :
Dont on peut noter la présence dans la même période. Beaucoup de noms de villages anciens ou de villages existants encore, ont des noms sérères. Les sérères se retirèrent peu à peu, vers le Sud Sénégal, après une série de défaites.
Les différentes races occupèrent le pays réellement, parfois jusqu’au Tagant. Elles achevèrent leur exode lors des invasions des Peulhs, venant du Macina, puis des Deniyankobé, venant du Fouta. Marty, soutient que c’est de la fusion de toutes ces races, qu’est sorti le peuple Toucouleur (P.292).
La révolution islamique de la dernière, moitié du dix-huitième siècle, lui donna la conscience de son unité nationale et religieuse. Il fortifia cette unité par de nombreuses luttes contre ses voisins, et particulièrement contre les tribus maures ; qui n’ont jamais cessé, jusqu’au dernier jour sur les deux rives du fleuve, de piller, de brûler et d’emmener les populations en esclavage, (P.292). Mais les rapports entre les Toucouleurs et les Tribus Maures n’étaient pas que conflictuels.
Au delà du métissage ethnique, l’appartenance commune à l’Islam, a également crée de nombreux liens spirituels qui se traduisent notamment, par les mêmes obédiences religieuses. Ainsi, Thierno Amadou Mokhtar Sakho, né en 1867 à Ségou, où son père, s’était établi à la suite d’El Hadj Omar Tall, y fit ses premières études et y commença le Droit.
Il étudia ensuite la Théologie et les Sciences Sacrées à Nioro et Kolomina et acheva son éducation chez El Harith Ould Maham des Id Ab Lahsen. « C’est un homme très instruit en Sciences arabes et islamiques. Intelligent, ouvert et pondéré, unissant à une profonde Science Juridique, une connaissance complète du Droit local et des traditions, et coutumes maures, toucouleurs. Il sait toujours trouver la solution idéale qui conciliera les intérêts de tout le monde.
Il jouit d’une autorité incontestée, même chez les maures. Dans les conflits qui divisent les nomades et les toucouleurs, on s’en remet par avance à sa décision (P.293) ». « On voit des Maures du Trarza , du Brakna, du Gorgol, le choisir comme arbitre supérieur.
Son influence, lui a permis de venir en aide à Yahya Kane, Chef des Irlabés Ebabés lors des recrutements intensifs. » Ahmadou Sakho a reçu a reçu le wird Tidjanis en 1890, de Mohamed Fall Ould Baba des Idaou Ali du Trarza et les pouvoirs de Moqqadem du Chek Saleh El Mekki ». « Il donnait des cours sur l’Afaya d’Ibn Bouna, la Rissala, la Soghra et la Ousta, la Tohfat et le Précis ».
Le Chef des Irlabes Ebrabés, Yahya Kane a été affilié à la Qadiriya par Cheikh Saad Bouh qu’il a rencontré à Saint-Louis, lors d’un voyage. Dans la préface du livre du Professeur Oumar Bâ, intitulé, « Le Fouta Toro, Carrefour des Civilisations. P.Lacroix soutient que :
« Par ses travaux sur les toponymes peulhs au Tagant et au Brakna, dont les résultats ont été publiés dans les Notes Africaines en 1968 et 1973, Oumar Bâ, se trouve être le premier à avoir démontrés, de façon irréfutable la présence antérieure d’un peuplement peulh dans ces régions, aujourd’hui parcourues par les maures » (P.6).
Oumar Bâ, soutient que le passage des peulhs dans le Brakna, Chef lieu Aleg est attesté par la Toponymie :
-Près d’Aleg, on peut apercevoir les Kedeyatt Ardoban (les petites montagnes d’Ardoban (Chef Peulh) ;
-Guelle N’Gurri, mis pour Galle N’Gari, ou enclos du taureau, en peulh (P.22)
-Lekki M’Babba, ou l’arbre de l’âne en peulh ;
-Diokke Touba, ou les prolongements du pantalon ;
-Asha Norwa, Ngaska Norwa, grotte du crocodile en peulh ;
-Beyla Maro, par Bêli Maro, les rizières en peulh ;
Dans le Tagant, on trouve :
-Tiâfol Kossam, jet de lait sortant du pis, en peulh ;
-Guini, déformation de Guini, essence qui abouti dans la zone, Guini fut le Chef lieu de la confédération des peulhs Diawbe que les maures désignaient sur le nom de Idagje.
Ce serait sous l’effet des assauts répétés des hordes de Koli Tengella, que les rescapés de cette confédération se dispersèrent au gré du hasard. Les Idagjmolle, maîtres actuels des lieux et de ses environs immédiats se disent encore apparentés aux peulhs.
-Boûr (roi en Ouolof), à une cinquantaine de kilomètres au S.O d’Aleg et à une trentaine de Podor aux abords de Chemana entre Regba et Legjet dépendait du Royaume de Diolof.
Sans nul doute, cette hégémonie ouolof a dû s’effacer suite à l’intervention brute des Deniyankobe (sous la direction de Koli Tengella) (P.23)
Il y’a également des sites exclusivement maures :
-Toomiyat
-Chelkhelt Weîss
-ELB EL Kasra
-Tin Yefdah
-Rag Tamarat
-Djigri
-Rag EL Chazi
-EL Far lâ
-EL Khair Fih
-NGénitan
-Ntichitt
-Ouadane
A propos des Sites historiques du Tagant, Oumar Bâ soutient :
« Le Sahel Mauritanien qui connaîtra une désertification de plus en plus marquée, était jusqu’à l’invasion des Almoravides, peuplé de noirs. Ababakr Ben Amar, un de ces fameux cavaliers de Mâli, sera abattu, dit la tradition par les Soninkés ou peut-être par les tribus peulhs, à mi-chemin entre Tidjikja et Boumdeid, au cœur même du Tagant » (P.26).
« L’on peut noter qu’en peulh, Tagant, est la prononciation défectueuse en maure de Tyehe Gene (tombes anciennes) et par extension villages anciens. » « Ce fut d’après Siré Abbas, la première étape de la dynastie des Dia Ogo dans leur descente vers le Sénégal, probablement avant la fin du IXème siècle » (P.26)
« Par ailleurs, la toponymie autorise à penser que le Tagant, comme le Brakna, a été autrefois, sinon habité par des populations noires, mais aussi, par les peulhs, au moins parcourus et pénétrés par eux. Ils suffisait de nous référer à certains termes qui n’ont aucun sens en maure, et qui, tout au contraire, en peulh, ne soutient aucune ambiguité, c’est le cas de :
-Addou Kaloumbam :
Addou, apporté, Kaloumbam : eau ayant servi au nettoyage du mil après son décorticage, qu’on appelle sottude.
-Bélignaar :
Veut dire un chapelet de mares, en peulh, bêli, c’est le pluriel de Weendu ; gnaar, connote l’idée de multitude, concernant notamment les étoiles » (P.26)
-EL Idaar :
Elb (dune en maure) d’Idaar-Idaar assurant les maures, est le souverain d’une tribu peulh, y ayant séjourné en des temps difficiles à déterminer » (P.26)
-Eri Yaara :
Serait la déformation maure de Ari Yara des peulhs. Cette expression désigne la passe dominant, la source de même nom au Tagant entre Tichitt et Tidjikja, qui veut dire en peulh : « qui y va s’y désaltère » (P.27).
-Garawol :
Est cette source à mi-chemin entre Moudjerria et Djouk, serpentant entre les roches, donc filiforme au point qu’on le compare à un garawol, ou fil en peulh, ou cordelette ;
-Gneyguira :
Diminutif féminin de Gangara, qui signifie en maure Sarakolé. En termes clairs, c’est la petite Sarakolé. L’occupation de cette région par les Soninkés de jadis, est un fait d’évidence, affirment les maures, maîtres actuels de Gneyguira (P.28). Au déla de l’eternel débat sur l’antériouté de l’occupation des différents aires géographiques par les ethnies composant le peuple mauritanien, il y’a une réalité têtue, qui est, que le peuple mauritanien est la symbiose de toutes ses composantes. Il y’a lieu d’en prendre acte et de le matérialiser dans les dispositions légales régissant le pays.
Cela pourrait se faire à travers l’officialisation de toutes les langues nationales. Ainsi, en même temps que la première langue officielle que l’enfant mauritanien, chousira, pour sa formation, ou pourrait rendre obligatoire l’apprentissage d’une seconde langue nationale, au choix de l’apprenant.
Cela permettra de légaliser une réalité déjà existante, mais qui doit être entérinée, et légalisée, et surtout assumée. Par ailleurs, la Mauritanie devrait retrouver sur le plan international son statut de pays-pont, entre l’Afrique Occidentale et le Maghreb, entre la Ligue Arabe et l’Union Africaine.
Tout en restant membre de l’Union du Maghreb Arabe, nous pensons que la Mauritanie devrait à terme, réintégrer la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et cela dans le cadre des dispositions des traités régissant ces deux organisations.
Un statut de pays charnière devait être prévu dans le cadre des dispositions régissant les relations internationales pour les pays comme la Mauritanie ; qui est à la jonction de deux ou plusieurs aires socio-culturelles, ou d’organisation d’intégration régionale.
En conclusion, nous pensons que la proposition de Mr Oiga Abdoulaye, d’appeler la Mauritanie Bilad Chinguitt, a le mérite de camper la réalité du métissage du peuple mauritanien au niveau interne et devait faire l’objet de larges débats. Le métissage de la Mauritanie n’est pas seulement une réalité au niveau intérieur, il est aussi transfrontalier. Le peuple mauritanien est fortement métissé avec les peuples des pays frontaliers, notamment, le Mali, le Maroc, le Sénégal.
Ne retrouve-t-on pas les mêmes tribus maures en Algérie, en Lybie, au Maroc, en Mauritanie, et au Sahara ? Cela n’est-il pas vrai pour les Halpoulares, les Oulofs, les Soninkés, les Maures avec le Mali et le Sénégal ? Ce que disait le Président Léopold Sedar Senghor, en parlant des relations entre la Mauritanie et le Sénégal, à savoir, « un peuple, deux pays », nous semble parfaitement valable avec tous les pays voisins de la Mauritanie.
Les anciens royaumes et empires transcendaient les frontières actuelles des Etats et c’est cela qui a expliqué dans le passé, certaines revendications territoriales que le principe de « l’intangibilité des frontières héritées du colonialisme a atténué. En conclusion, nous pensions qu’il est temps que la Mauritanie assume son passé, fait de métissage, de tolérance, afin que chaque citoyen se reconnaisse dans son pays.
Fait à Nouakchott, le 01 Octobre 2012
Cheikh Mamadou Kane
Ancien Secrétaire Général du Ministère des Finances
Source : Le Rénovateur Quotidien
Le traitement le plus récent de ce thème, est l’analyse pondérée faite par Monsieur Oiga Abdoulaye, Ancien Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale intitulée : « Contribution au rétablissement de la vérité sur le peuplement historique de la Mauritanie ».
Il soutient notamment que : « L’une des conclusions qu’on peut tirer de son analyse, est que le peuple mauritanien, est un peuple métissé et que c’est dans le métissage, qu’il trouvera son salut ». Pour illustrer ce métissage, il donne quelques exemples significatifs :
-Les Mechdouf et les Oulad M’Bareck, sont fortement métissés avec les Soninkés, les Fulani, et les Bambaras ;
-Les Laghlal, le sont avec les Soninkés ;
-La célèbre famille des Cheikh :
Cheikh Mohamed Fadel, Cheikh El Hadrami, Cheikh Saad Bouh, Cheikh Sidi Bouya, ont pour mère Khadijetou, fille de Boubacar Bal, lui-même, fils du célèbre marabout Souleymane Bal.
« C’est Souleymane Bal, qui combattait les tribus maures, qui imposaient au Fouta, le paiement d’un tribut, appelé par les gens du Fouta, Moudo Horma, jusqu’à sa suppression… »
-La famille de Ehel Meyda, descendrait de Koli Tengella.
-La tribu Degjmolle, serait d’origine Foulbé Jaawbé, devenue maure par assimilation.
« Par ailleurs, poursuit Mr Oiga, les cités historiques telles que Oualata, Chinguitti, Tichit, ont d’abord été habitées par les Soninkés. « Chinguitti signifie en Soninké : (Sii N’Guede), c'est-à-dire, le puits du cheval »
Il soutient, que sa mosquée qui fait 16 à 17 mètres de hauteur, et qui constitue, la fierté des gens du Bilad Chinguitti, a été construite par un Soninké, du nom de Namori Camara ; en 620, après le prophète Mohamed (PSL). Il y fut imam, son nom était écrit sur le mur de la mosquée.
La ville d’Oualata s’appelait Bouri, c'est-à-dire des hangars, en Soninké. Cette cité historique, a changé de nom pour être Djoulata, à cause de son activité commerciale, puis Djoulata a été déformé pour devenir Oualata. Par consacrer cette réalité métissée, Mr Oiga, propose au peuple mauritanien, dans le cadre d’un référendum, d’adopter le nom de Bilad El Chinguitt, pour la Mauritanie.
(Il appartient donc aux mauritaniens d’instaurer un débat apaisé autour de cette question). Le métissage du peuple mauritanien, ne se situe pas uniquement au niveau interne de ses tribus et ethnies, il est transfrontalier. Il est illustré par de nombreux cas historiques, dont, entre autres, l’union de Diombott M’Bodj, reine du Oualo, avec l’Emir du Trarza.
Dans « les Tribus Maures et l’Islam (1920), Paul Marty, soutient que le Chamana est aujourd’hui à peu près exclusivement peuplé et cultivé par les Toucouleurs et les Haratins-Maures.
Ces derniers, presque sédentaires, quoique continuant à habiter la tente, ont leurs campements établis ordinairement à la limite de la région sablonneuse ».
Il soutient que d’autres races habitaient le Chamana dans le passé :
-les Ouolofs :
Probablement, au Moyen-âge, ils étaient installés vraisemblablement beaucoup plus au Nord ; mais reculèrent peu à peu vers le Fleuve, sous la pression des tribus peulh Bababé, et les tribus berbères maures.
-les sérères :
Dont on peut noter la présence dans la même période. Beaucoup de noms de villages anciens ou de villages existants encore, ont des noms sérères. Les sérères se retirèrent peu à peu, vers le Sud Sénégal, après une série de défaites.
Les différentes races occupèrent le pays réellement, parfois jusqu’au Tagant. Elles achevèrent leur exode lors des invasions des Peulhs, venant du Macina, puis des Deniyankobé, venant du Fouta. Marty, soutient que c’est de la fusion de toutes ces races, qu’est sorti le peuple Toucouleur (P.292).
La révolution islamique de la dernière, moitié du dix-huitième siècle, lui donna la conscience de son unité nationale et religieuse. Il fortifia cette unité par de nombreuses luttes contre ses voisins, et particulièrement contre les tribus maures ; qui n’ont jamais cessé, jusqu’au dernier jour sur les deux rives du fleuve, de piller, de brûler et d’emmener les populations en esclavage, (P.292). Mais les rapports entre les Toucouleurs et les Tribus Maures n’étaient pas que conflictuels.
Au delà du métissage ethnique, l’appartenance commune à l’Islam, a également crée de nombreux liens spirituels qui se traduisent notamment, par les mêmes obédiences religieuses. Ainsi, Thierno Amadou Mokhtar Sakho, né en 1867 à Ségou, où son père, s’était établi à la suite d’El Hadj Omar Tall, y fit ses premières études et y commença le Droit.
Il étudia ensuite la Théologie et les Sciences Sacrées à Nioro et Kolomina et acheva son éducation chez El Harith Ould Maham des Id Ab Lahsen. « C’est un homme très instruit en Sciences arabes et islamiques. Intelligent, ouvert et pondéré, unissant à une profonde Science Juridique, une connaissance complète du Droit local et des traditions, et coutumes maures, toucouleurs. Il sait toujours trouver la solution idéale qui conciliera les intérêts de tout le monde.
Il jouit d’une autorité incontestée, même chez les maures. Dans les conflits qui divisent les nomades et les toucouleurs, on s’en remet par avance à sa décision (P.293) ». « On voit des Maures du Trarza , du Brakna, du Gorgol, le choisir comme arbitre supérieur.
Son influence, lui a permis de venir en aide à Yahya Kane, Chef des Irlabés Ebabés lors des recrutements intensifs. » Ahmadou Sakho a reçu a reçu le wird Tidjanis en 1890, de Mohamed Fall Ould Baba des Idaou Ali du Trarza et les pouvoirs de Moqqadem du Chek Saleh El Mekki ». « Il donnait des cours sur l’Afaya d’Ibn Bouna, la Rissala, la Soghra et la Ousta, la Tohfat et le Précis ».
Le Chef des Irlabes Ebrabés, Yahya Kane a été affilié à la Qadiriya par Cheikh Saad Bouh qu’il a rencontré à Saint-Louis, lors d’un voyage. Dans la préface du livre du Professeur Oumar Bâ, intitulé, « Le Fouta Toro, Carrefour des Civilisations. P.Lacroix soutient que :
« Par ses travaux sur les toponymes peulhs au Tagant et au Brakna, dont les résultats ont été publiés dans les Notes Africaines en 1968 et 1973, Oumar Bâ, se trouve être le premier à avoir démontrés, de façon irréfutable la présence antérieure d’un peuplement peulh dans ces régions, aujourd’hui parcourues par les maures » (P.6).
Oumar Bâ, soutient que le passage des peulhs dans le Brakna, Chef lieu Aleg est attesté par la Toponymie :
-Près d’Aleg, on peut apercevoir les Kedeyatt Ardoban (les petites montagnes d’Ardoban (Chef Peulh) ;
-Guelle N’Gurri, mis pour Galle N’Gari, ou enclos du taureau, en peulh (P.22)
-Lekki M’Babba, ou l’arbre de l’âne en peulh ;
-Diokke Touba, ou les prolongements du pantalon ;
-Asha Norwa, Ngaska Norwa, grotte du crocodile en peulh ;
-Beyla Maro, par Bêli Maro, les rizières en peulh ;
Dans le Tagant, on trouve :
-Tiâfol Kossam, jet de lait sortant du pis, en peulh ;
-Guini, déformation de Guini, essence qui abouti dans la zone, Guini fut le Chef lieu de la confédération des peulhs Diawbe que les maures désignaient sur le nom de Idagje.
Ce serait sous l’effet des assauts répétés des hordes de Koli Tengella, que les rescapés de cette confédération se dispersèrent au gré du hasard. Les Idagjmolle, maîtres actuels des lieux et de ses environs immédiats se disent encore apparentés aux peulhs.
-Boûr (roi en Ouolof), à une cinquantaine de kilomètres au S.O d’Aleg et à une trentaine de Podor aux abords de Chemana entre Regba et Legjet dépendait du Royaume de Diolof.
Sans nul doute, cette hégémonie ouolof a dû s’effacer suite à l’intervention brute des Deniyankobe (sous la direction de Koli Tengella) (P.23)
Il y’a également des sites exclusivement maures :
-Toomiyat
-Chelkhelt Weîss
-ELB EL Kasra
-Tin Yefdah
-Rag Tamarat
-Djigri
-Rag EL Chazi
-EL Far lâ
-EL Khair Fih
-NGénitan
-Ntichitt
-Ouadane
A propos des Sites historiques du Tagant, Oumar Bâ soutient :
« Le Sahel Mauritanien qui connaîtra une désertification de plus en plus marquée, était jusqu’à l’invasion des Almoravides, peuplé de noirs. Ababakr Ben Amar, un de ces fameux cavaliers de Mâli, sera abattu, dit la tradition par les Soninkés ou peut-être par les tribus peulhs, à mi-chemin entre Tidjikja et Boumdeid, au cœur même du Tagant » (P.26).
« L’on peut noter qu’en peulh, Tagant, est la prononciation défectueuse en maure de Tyehe Gene (tombes anciennes) et par extension villages anciens. » « Ce fut d’après Siré Abbas, la première étape de la dynastie des Dia Ogo dans leur descente vers le Sénégal, probablement avant la fin du IXème siècle » (P.26)
« Par ailleurs, la toponymie autorise à penser que le Tagant, comme le Brakna, a été autrefois, sinon habité par des populations noires, mais aussi, par les peulhs, au moins parcourus et pénétrés par eux. Ils suffisait de nous référer à certains termes qui n’ont aucun sens en maure, et qui, tout au contraire, en peulh, ne soutient aucune ambiguité, c’est le cas de :
-Addou Kaloumbam :
Addou, apporté, Kaloumbam : eau ayant servi au nettoyage du mil après son décorticage, qu’on appelle sottude.
-Bélignaar :
Veut dire un chapelet de mares, en peulh, bêli, c’est le pluriel de Weendu ; gnaar, connote l’idée de multitude, concernant notamment les étoiles » (P.26)
-EL Idaar :
Elb (dune en maure) d’Idaar-Idaar assurant les maures, est le souverain d’une tribu peulh, y ayant séjourné en des temps difficiles à déterminer » (P.26)
-Eri Yaara :
Serait la déformation maure de Ari Yara des peulhs. Cette expression désigne la passe dominant, la source de même nom au Tagant entre Tichitt et Tidjikja, qui veut dire en peulh : « qui y va s’y désaltère » (P.27).
-Garawol :
Est cette source à mi-chemin entre Moudjerria et Djouk, serpentant entre les roches, donc filiforme au point qu’on le compare à un garawol, ou fil en peulh, ou cordelette ;
-Gneyguira :
Diminutif féminin de Gangara, qui signifie en maure Sarakolé. En termes clairs, c’est la petite Sarakolé. L’occupation de cette région par les Soninkés de jadis, est un fait d’évidence, affirment les maures, maîtres actuels de Gneyguira (P.28). Au déla de l’eternel débat sur l’antériouté de l’occupation des différents aires géographiques par les ethnies composant le peuple mauritanien, il y’a une réalité têtue, qui est, que le peuple mauritanien est la symbiose de toutes ses composantes. Il y’a lieu d’en prendre acte et de le matérialiser dans les dispositions légales régissant le pays.
Cela pourrait se faire à travers l’officialisation de toutes les langues nationales. Ainsi, en même temps que la première langue officielle que l’enfant mauritanien, chousira, pour sa formation, ou pourrait rendre obligatoire l’apprentissage d’une seconde langue nationale, au choix de l’apprenant.
Cela permettra de légaliser une réalité déjà existante, mais qui doit être entérinée, et légalisée, et surtout assumée. Par ailleurs, la Mauritanie devrait retrouver sur le plan international son statut de pays-pont, entre l’Afrique Occidentale et le Maghreb, entre la Ligue Arabe et l’Union Africaine.
Tout en restant membre de l’Union du Maghreb Arabe, nous pensons que la Mauritanie devrait à terme, réintégrer la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et cela dans le cadre des dispositions des traités régissant ces deux organisations.
Un statut de pays charnière devait être prévu dans le cadre des dispositions régissant les relations internationales pour les pays comme la Mauritanie ; qui est à la jonction de deux ou plusieurs aires socio-culturelles, ou d’organisation d’intégration régionale.
En conclusion, nous pensons que la proposition de Mr Oiga Abdoulaye, d’appeler la Mauritanie Bilad Chinguitt, a le mérite de camper la réalité du métissage du peuple mauritanien au niveau interne et devait faire l’objet de larges débats. Le métissage de la Mauritanie n’est pas seulement une réalité au niveau intérieur, il est aussi transfrontalier. Le peuple mauritanien est fortement métissé avec les peuples des pays frontaliers, notamment, le Mali, le Maroc, le Sénégal.
Ne retrouve-t-on pas les mêmes tribus maures en Algérie, en Lybie, au Maroc, en Mauritanie, et au Sahara ? Cela n’est-il pas vrai pour les Halpoulares, les Oulofs, les Soninkés, les Maures avec le Mali et le Sénégal ? Ce que disait le Président Léopold Sedar Senghor, en parlant des relations entre la Mauritanie et le Sénégal, à savoir, « un peuple, deux pays », nous semble parfaitement valable avec tous les pays voisins de la Mauritanie.
Les anciens royaumes et empires transcendaient les frontières actuelles des Etats et c’est cela qui a expliqué dans le passé, certaines revendications territoriales que le principe de « l’intangibilité des frontières héritées du colonialisme a atténué. En conclusion, nous pensions qu’il est temps que la Mauritanie assume son passé, fait de métissage, de tolérance, afin que chaque citoyen se reconnaisse dans son pays.
Fait à Nouakchott, le 01 Octobre 2012
Cheikh Mamadou Kane
Ancien Secrétaire Général du Ministère des Finances
Source : Le Rénovateur Quotidien

 Actualités
Actualités


















