Moktar Ould Daddah né en 1924 dans une famille appartenant à une tribu maraboutique, les Oulad Biri, à Boutilimit, dans le sud-ouest de la Mauritanie, est considéré comme le « père de la nation »). Au pouvoir jusqu’en 1978 et mort en 2003 à Paris. Il fut élu pour la première en 1957, vice président, du premier conseil de gouvernement issu de la loi-cadre Deferre[1]. Ses années de pouvoir se transformèrent à un régime paternaliste. Il usait et abusait de cette rhétorique qui faisait de lui le « père » et les citoyens « ses enfants ». Michel Pinçon dans son article « un patronat paternel, 1985 » définit le paternalisme comme « un rapport social dont l’inégalité est déviée, transfigurée par une métaphore sociale, qui assimile le détenteur de l’autorité à un père et les agents soumis à cette autorité, à ses enfants »[2].
Ould Daddah était élu président de la république, le 20 août 1961 et créa en décembre, le Parti du Peuple Mauritanien (PPM) et réélu trois fois : en 1966, 1971 et 1976. Le pouvoir de Daddah ne croyait pas à la possibilité d’instaurer une démocratie en Mauritanie[3]. La définition de Pinçon dans laquelle s’inscrit la rhétorique paternaliste mauritanienne entre les citoyens et le pouvoir. Les années de pouvoir de Mokhtar contourne toutes les logiques de la nation pour se transformait à un pouvoir tribal.
En mars 1963, plusieurs mesures furent prises : une large suprématie sur les autres institutions de l’Etat, la suppression des chefferies, un vote au renoncement des subventions versées annuellement par la France. En octobre 1963, les cadres du PPM instaura le monopartisme et fut reconnu en janvier 1965 comme l’unique parti de l’Etat dans la constitution. Le PPM se justifiait, soit disant qu’il veut construire l’unité nationale. Le multipartisme étant accusé de favoriser les forces centrifuges (DEVEY MURIEL, P.151). En réalité, le PPM était devenue un parti tribal et s’était investi par les notables maures (beïdanes). L’idée de construire une nation mauritanienne fut écartée (Ibid., P.151). Les conséquences du monopartisme étaient l’interdiction du Front National Démocratique (FND) ainsi que les autres partis et il n’existait qu’un seul syndicat : l’Union des Travailleurs Mauritaniens (UTM) [4].
Mais comme l’indépendance a donnée naissance à des nouvelles catégories sociales, les choses se sont déroulées autrement. A la fin des années 1960, la situation économique du pays dégradée, ce qui s’est traduit par la première grève de travailleurs dans le pays, faisant sept morts. La grève a commencé à la société minière (Miferma, une société française) à Zouerate, le 29 mais 1968, symbole de la croissance économique extravertie. Cette insurrection avait donné lieu plus tard à une succession des grèves dans tout le pays : En 1969, les enseignants du primaire, puis en 1971 toutes les grandes entreprises se sont mises à la grève y compris la Miferma et l’Imapec (Mauritanienne de pêche). Les étudiants étaient les plus vindicatifs entre 1969 et 1974, fondant en 1971, un syndicat, l’Union Générale des Etudiants et Stagiaires de Mauritanie (Ugesm), pour faire front au pouvoir. Les campagnes, dans le même temps, étaient touchées par la sécheresse (surtout au Sahel), créant un mouvement de masses des populations dans les besoins qui se soulevèrent contre le pouvoir, provoquant également un fort exode rural et la sédentarisation de nombreux nomades maures induisant un creusement du fossé entre riches et pauvres.
Le père fondateur a utilisé la répression – des arrestations – couvre feu – et emprisonnements durant cette période de crise allant de 1968 à 1973. La sortie de crise fut un échec pour le pouvoir, la création du parti des « khadihines » (les prolétaires) de Mauritanie (PKM) en 1973 met fin à l’unipartisme et fait pression sur le pouvoir en place. Le pouvoir entame une politique économique de relance et nationalisation : la Miferma qui était une société française est nationalisée et devient la SNIM (société nationale d’industries minières). Une nouvelle monnaie (Ouguiyas) est mise en circulation en 1973 et le pays sort de la zone Franc CFA.
L’Etat soucieux de maintenir la stabilité attribue en 1974, des postes de responsabilité aux jeunes contestataires. Après une année de sortie de la crise économique, le pouvoir s’était engagé dans la guerre au Sahara. Une guerre qui va précipiter le départ du régime.
En juin 1976, un commando du Front Polisario (Sahara) a tenté de renverser le pouvoir de Nouakchott. Un train de la région minière (Zouerate) subissait une attaque en 1977, ce qui va obliger le pouvoir pro-arabe à se tourner vers son ancien colonisateur, en acceptant une aide militaire et logistique de la France. Une partie du peuple mauritanien qui n’était pas favorable aux hostilités de la guerre qui provoquait toutes ses tentatives de coup d’Etat, va manifester son mécontentement. Les maures des régions frontalières soutenaient le Front Polisario contre le pouvoir. A cause de la guerre, l’économie de la Mauritanie entrait de nouveau en crise.
Le rapprochement avec la France va poser problème aux pays arabes conservateurs et l’alliance marocaine et ils mettent fin à leur relation. Au niveau national, le président se trouvait ainsi dans une situation de plus en plus isolée et va convoquer un congrès d’urgence en janvier 1978, pour rassurer ses partisans et tenter d’intimider les opposants. Le pouvoir fut renversé finalement le 10 juillet 1978, par un premier coup d’Etat qui réveillait une compétition tribale pour conquérir le pouvoir[5].
Une période trouble marquée par une succession de coup d’Etat : trois coups d’État militaires de 1978 à 1984. Les différents coups d’Etat affrontaient s’est déclaré entre clans ou tribus aux sympathies affichées (Maroc, Algérie, Libye, Polisario et Irak). Cela va donner lieu à une succession de coup d’Etat les tribus guerrières (les Béni Hassan) et les tribus marabouts (mélange de Béni hassan et berbères), toutes deux au sommet de la hiérarchie sociale maure.
Le Comité Militaire de Redressement National (CMRN) qui prend le pouvoir le 10 juillet 1978, avait à sa tête Moustafa Ould Mohammad Saleck qui était issu d’une tribu guerrière. Le CMRN se justifiait par la nécessité de sauver le pays et de sauvegarder l’unité nationale. Il supprime la constitution, en dissolvant le parlement et le PPM. Les putschistes reprochaient au pouvoir son rapprochement avec le Maroc, au détriment du Front Polisario mis en difficulté par les accords de Madrid (qui avait créé un tripartite entre Maroc, Espagne et Mauritanie contre le Front Polisario). Le CMRN prônait un retour aux traditions de «l’islam » mais fut rapidement renversé car la «question sahraouie» créait des dissensions au sein de l’armée. La première contestation était provenue du ministre de l’intérieur Jeddou Ould Salek, qui avait tenté de retourner les alliances au profit du Polisario et Alger. Suite à ses multiples oppositions, le pouvoir du CMRN fut renversé par les pro-marocains en avril 1979. Le cadre institutionnel fut remanié.
Le CMRN s’est transformé en Comité Militaire de Salut National (CMSN). Le pouvoir du CMSN était le plus court. Le lieutenant Ahmed Ould Bouceif (issu d’une tribu guerrière), à la tête du putsch s’était justifié, en proclamant que le pays est en danger de guerre qui nécessitait en redressement. Ce dernier mourut deux mois après dans un accident d’avion laissant le champ libre aux pro-Polisario qui reprirent la tête de l’Etat. Les pro-Polisario nomment Mouhammad Khouna Ould Haidallah au poste de premier ministre et Moustafa Ould Mouhammad Salek, l’auteur du CMRN et président déchu en 1979, de nouveau désigné président. Il tente de prendre le contrôle total du pays et fut chassé quelques semaines plus tard. Le lieutenant-colonel Mouhammad Ould Mahmoud Louly, un ancien camarade d’Ould Haidallah remplaça Ould Mouhammad Salek comme président du pays en juin 1979. Le premier ministre Ould Haidallah envoya très vite le lieutenant-colonel Ahmed Ould Sidi signé, à Alger, l’accord de paix avec le Polisario. La Mauritanie sortit alors de la guerre le 5 Août 1979 en signant les « accords d’Alger ».
Mouhammad Khouna Ould Haidallah considéré comme le héros de la paix du Sahara accède à la présidence du pays le 4 janvier 1980, en écartant le président Mouhammad Mahmoud Ould Louly et les pro-marocains qui siégeaient encore au sein de l’armée. Il s’est attribué les pleins pouvoirs et adopta la «charia» selon le modèle présidentiel de juillet 1978. Les pro-marocains, les pro-libyens et d’autres mouvements maures et négro-africains tentèrent de déséquilibrer le pouvoir, mais il réussit à déjouer les complots jusqu’en 1984.
Ce modèle autocratique conservateur a renforcé nettement les oppositions entre communautés (Muriel Devey, 2005). Cela s’est traduit par la création des plusieurs mouvements clandestins : les milieux arabisants, le Baath lié à l’Irak, les Nassériens ou nationalistes arabes et les FLAM des négro-africains (forces de libération des Africains). La période de trouble finie par donner de naissance, un régime sanguinaire, par coup d’Etat en 1984.
DIAKITE Boulaye
Bibliographie
[1] Alain ANTIL, « OULD DADDAH MOKTAR – (1924-2003) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 26 avril 2015.
[2] Pinçon Michel. Un patronat paternel. In : Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 57-58, juin 1985, P. 95.
[3] Alain ANTIL, « OULD DADDAH MOKTAR – (1924-2003) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 26 avril 2015.
[4] DEVEY. M, La Mauritanie, Editions Karthala, 2005, PP. 149-158.
[5] DEVEY. M, La Mauritanie, Editions Karthala, 2005, PP. 149-158.
Ould Daddah était élu président de la république, le 20 août 1961 et créa en décembre, le Parti du Peuple Mauritanien (PPM) et réélu trois fois : en 1966, 1971 et 1976. Le pouvoir de Daddah ne croyait pas à la possibilité d’instaurer une démocratie en Mauritanie[3]. La définition de Pinçon dans laquelle s’inscrit la rhétorique paternaliste mauritanienne entre les citoyens et le pouvoir. Les années de pouvoir de Mokhtar contourne toutes les logiques de la nation pour se transformait à un pouvoir tribal.
En mars 1963, plusieurs mesures furent prises : une large suprématie sur les autres institutions de l’Etat, la suppression des chefferies, un vote au renoncement des subventions versées annuellement par la France. En octobre 1963, les cadres du PPM instaura le monopartisme et fut reconnu en janvier 1965 comme l’unique parti de l’Etat dans la constitution. Le PPM se justifiait, soit disant qu’il veut construire l’unité nationale. Le multipartisme étant accusé de favoriser les forces centrifuges (DEVEY MURIEL, P.151). En réalité, le PPM était devenue un parti tribal et s’était investi par les notables maures (beïdanes). L’idée de construire une nation mauritanienne fut écartée (Ibid., P.151). Les conséquences du monopartisme étaient l’interdiction du Front National Démocratique (FND) ainsi que les autres partis et il n’existait qu’un seul syndicat : l’Union des Travailleurs Mauritaniens (UTM) [4].
Mais comme l’indépendance a donnée naissance à des nouvelles catégories sociales, les choses se sont déroulées autrement. A la fin des années 1960, la situation économique du pays dégradée, ce qui s’est traduit par la première grève de travailleurs dans le pays, faisant sept morts. La grève a commencé à la société minière (Miferma, une société française) à Zouerate, le 29 mais 1968, symbole de la croissance économique extravertie. Cette insurrection avait donné lieu plus tard à une succession des grèves dans tout le pays : En 1969, les enseignants du primaire, puis en 1971 toutes les grandes entreprises se sont mises à la grève y compris la Miferma et l’Imapec (Mauritanienne de pêche). Les étudiants étaient les plus vindicatifs entre 1969 et 1974, fondant en 1971, un syndicat, l’Union Générale des Etudiants et Stagiaires de Mauritanie (Ugesm), pour faire front au pouvoir. Les campagnes, dans le même temps, étaient touchées par la sécheresse (surtout au Sahel), créant un mouvement de masses des populations dans les besoins qui se soulevèrent contre le pouvoir, provoquant également un fort exode rural et la sédentarisation de nombreux nomades maures induisant un creusement du fossé entre riches et pauvres.
Le père fondateur a utilisé la répression – des arrestations – couvre feu – et emprisonnements durant cette période de crise allant de 1968 à 1973. La sortie de crise fut un échec pour le pouvoir, la création du parti des « khadihines » (les prolétaires) de Mauritanie (PKM) en 1973 met fin à l’unipartisme et fait pression sur le pouvoir en place. Le pouvoir entame une politique économique de relance et nationalisation : la Miferma qui était une société française est nationalisée et devient la SNIM (société nationale d’industries minières). Une nouvelle monnaie (Ouguiyas) est mise en circulation en 1973 et le pays sort de la zone Franc CFA.
L’Etat soucieux de maintenir la stabilité attribue en 1974, des postes de responsabilité aux jeunes contestataires. Après une année de sortie de la crise économique, le pouvoir s’était engagé dans la guerre au Sahara. Une guerre qui va précipiter le départ du régime.
En juin 1976, un commando du Front Polisario (Sahara) a tenté de renverser le pouvoir de Nouakchott. Un train de la région minière (Zouerate) subissait une attaque en 1977, ce qui va obliger le pouvoir pro-arabe à se tourner vers son ancien colonisateur, en acceptant une aide militaire et logistique de la France. Une partie du peuple mauritanien qui n’était pas favorable aux hostilités de la guerre qui provoquait toutes ses tentatives de coup d’Etat, va manifester son mécontentement. Les maures des régions frontalières soutenaient le Front Polisario contre le pouvoir. A cause de la guerre, l’économie de la Mauritanie entrait de nouveau en crise.
Le rapprochement avec la France va poser problème aux pays arabes conservateurs et l’alliance marocaine et ils mettent fin à leur relation. Au niveau national, le président se trouvait ainsi dans une situation de plus en plus isolée et va convoquer un congrès d’urgence en janvier 1978, pour rassurer ses partisans et tenter d’intimider les opposants. Le pouvoir fut renversé finalement le 10 juillet 1978, par un premier coup d’Etat qui réveillait une compétition tribale pour conquérir le pouvoir[5].
Une période trouble marquée par une succession de coup d’Etat : trois coups d’État militaires de 1978 à 1984. Les différents coups d’Etat affrontaient s’est déclaré entre clans ou tribus aux sympathies affichées (Maroc, Algérie, Libye, Polisario et Irak). Cela va donner lieu à une succession de coup d’Etat les tribus guerrières (les Béni Hassan) et les tribus marabouts (mélange de Béni hassan et berbères), toutes deux au sommet de la hiérarchie sociale maure.
Le Comité Militaire de Redressement National (CMRN) qui prend le pouvoir le 10 juillet 1978, avait à sa tête Moustafa Ould Mohammad Saleck qui était issu d’une tribu guerrière. Le CMRN se justifiait par la nécessité de sauver le pays et de sauvegarder l’unité nationale. Il supprime la constitution, en dissolvant le parlement et le PPM. Les putschistes reprochaient au pouvoir son rapprochement avec le Maroc, au détriment du Front Polisario mis en difficulté par les accords de Madrid (qui avait créé un tripartite entre Maroc, Espagne et Mauritanie contre le Front Polisario). Le CMRN prônait un retour aux traditions de «l’islam » mais fut rapidement renversé car la «question sahraouie» créait des dissensions au sein de l’armée. La première contestation était provenue du ministre de l’intérieur Jeddou Ould Salek, qui avait tenté de retourner les alliances au profit du Polisario et Alger. Suite à ses multiples oppositions, le pouvoir du CMRN fut renversé par les pro-marocains en avril 1979. Le cadre institutionnel fut remanié.
Le CMRN s’est transformé en Comité Militaire de Salut National (CMSN). Le pouvoir du CMSN était le plus court. Le lieutenant Ahmed Ould Bouceif (issu d’une tribu guerrière), à la tête du putsch s’était justifié, en proclamant que le pays est en danger de guerre qui nécessitait en redressement. Ce dernier mourut deux mois après dans un accident d’avion laissant le champ libre aux pro-Polisario qui reprirent la tête de l’Etat. Les pro-Polisario nomment Mouhammad Khouna Ould Haidallah au poste de premier ministre et Moustafa Ould Mouhammad Salek, l’auteur du CMRN et président déchu en 1979, de nouveau désigné président. Il tente de prendre le contrôle total du pays et fut chassé quelques semaines plus tard. Le lieutenant-colonel Mouhammad Ould Mahmoud Louly, un ancien camarade d’Ould Haidallah remplaça Ould Mouhammad Salek comme président du pays en juin 1979. Le premier ministre Ould Haidallah envoya très vite le lieutenant-colonel Ahmed Ould Sidi signé, à Alger, l’accord de paix avec le Polisario. La Mauritanie sortit alors de la guerre le 5 Août 1979 en signant les « accords d’Alger ».
Mouhammad Khouna Ould Haidallah considéré comme le héros de la paix du Sahara accède à la présidence du pays le 4 janvier 1980, en écartant le président Mouhammad Mahmoud Ould Louly et les pro-marocains qui siégeaient encore au sein de l’armée. Il s’est attribué les pleins pouvoirs et adopta la «charia» selon le modèle présidentiel de juillet 1978. Les pro-marocains, les pro-libyens et d’autres mouvements maures et négro-africains tentèrent de déséquilibrer le pouvoir, mais il réussit à déjouer les complots jusqu’en 1984.
Ce modèle autocratique conservateur a renforcé nettement les oppositions entre communautés (Muriel Devey, 2005). Cela s’est traduit par la création des plusieurs mouvements clandestins : les milieux arabisants, le Baath lié à l’Irak, les Nassériens ou nationalistes arabes et les FLAM des négro-africains (forces de libération des Africains). La période de trouble finie par donner de naissance, un régime sanguinaire, par coup d’Etat en 1984.
DIAKITE Boulaye
Bibliographie
[1] Alain ANTIL, « OULD DADDAH MOKTAR – (1924-2003) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 26 avril 2015.
[2] Pinçon Michel. Un patronat paternel. In : Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 57-58, juin 1985, P. 95.
[3] Alain ANTIL, « OULD DADDAH MOKTAR – (1924-2003) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 26 avril 2015.
[4] DEVEY. M, La Mauritanie, Editions Karthala, 2005, PP. 149-158.
[5] DEVEY. M, La Mauritanie, Editions Karthala, 2005, PP. 149-158.


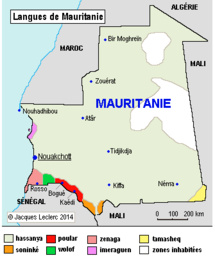
 Actualités
Actualités



















