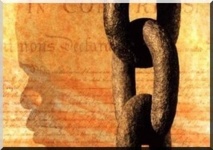
Depuis son indépendance en novembre 1960, la république islamique de Mauritanie pour faire comme les autres a intégré dans toutes ses dispositions légales tous les instruments juridiques incriminant la pratique du phénomène de l’esclavage. Toutes les constitutions nationales de 1961 à celle de 1991 stipulent clairement que tous les Mauritaniens sont strictement égaux. L’ordonnance militaire de 1981 abolit en termes on ne peut plus clair le phénomène. C’est ce que les nostalgiques d’une certaine époque appellent en riant sous turban : La liberté de Haidalla. Saccade de textes dénonçant et interdisant l’asservissement. La loi 00/48/2007
constitue un tournant, malgré ses nombreuses insuffisances. L’action des anciens esclaves eux-mêmes a fortement contribué à secouer le cocotier. Déjà en 1978, naissance du premier mouvement qui plaide pour la promotion des Harratines. L’engagement très intense des organisations de la société civile, notamment SOS Esclaves créée en 1995 et qui n’a été reconnue qu’en 2005, juste à quelques mois de la chute du Président Maouiya Ould Sid’ Ahmed Taya. Les nouvelles exigences de la Communauté internationale qui conditionne certains de ses rapports à la manière avec laquelle les pays prennent en compte la problématique des droits de l’homme. Malgré tout ça, la question de l’esclavage divise. Le pouvoir et ses cercles administratifs, sécuritaires, politiques et judiciaires ne veulent entendre parler que de séquelles. Alors que certaines organisations des droits de l’homme assurent l’existence de pratiques esclavagistes sur l’ensemble du territoire national. Combien d’esclaves ? Impossible de savoir. En dehors de quelques chiffres fantaisistes, aucune statistique officielle ne permet de mesurer l’ampleur réelle du phénomène. Le 29 avril 2013, le Manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Harratines recommandait le lancement d’une enquête quantitative et qualitative pour mesurer le phénomène en termes de pratiques, de survivances et de séquelles. Enquête.
Aichana Mint Ebeid : Une victime qui se meurt
Quelques parts, comme si elle voulait se faire oublier, échapper aux regards inquisiteurs des autres, Aichana Mint Ebeid, l’une des premières victimes de l’esclavage que SOS Esclaves a pu extraire en 1996 au calvaire de la servitude nous accueille avec une certaine méfiance et un brin de lassitude et de désespoir. Son histoire, elle l’a maintes fois ressassée au point que ses filles devenues grandes ne supportent plus qu’elles en parlent. Heureusement, aujourd’hui, elles ne sont pas là. Dans sa modeste chambre où un téléviseur rebelle refuse de s’allumer Aichana nous apprend qu’elle ne travaille plus depuis plusieurs mois à cause de la maladie de son benjamin El Houssein (13 ans) qu’un mal qu’aucune analyse ni aucun marabout n’a pu détecter selon les propos d’Aichana. Je vis dit –elle grâce à la bonté d’Allah et du soutien de quelques bonnes volontés. Lorsqu’elle évoque ses randonnées entre Tambaz et Lemteyen pour être au service de ses maîtres, les Ehl Mouhamadou et les Ehl Moissa, tantôt dans les rizières ou comme domestique bonne à tout faire suivant le système de « Teywil » qui consiste à ce que deux familles de maîtres se partagent la force de travail d’un seul esclave. Lorsqu’en 1996 elle sollicite l’aide de SOS Esclaves encore non reconnue, Aichana ne savait pas qu’il lui faudrait beaucoup de tracasseries pour pouvoir récupérer ses enfants restés chez ses maîtres dans les confins du Trarza. Une affaire dont parla à l’époque la chaîne de télévision FR3 et qui valut à Boubacar Ould Messaoud, Me Brahim Ould Ebetty, Me Fatimata M’baye et le Professeur Cheikh Saad Bouh Kamara un séjour en prison pour administration d’organisation non reconnue pour certains d’entre eux et autres arguments fallacieux pour d’autres. Dix sept ans après sa libération, Aichana lutte encore pour son émancipation. Ses enfants n’ont pas encore d’état civil. Sa vie dépend encore de son labeur et de son engagement. Esquissant un sourire évocateur, Aichana ne se rappelle plus exactement des détails de son histoire. Mais elle est sûre que ce n’était pas une sinécure. C’était un infernal enfer d’un travail continu et de régulières violences pour la moindre insatisfaction. Entre deux mots, Aichana à peine la quarantaine préfère détourner la discussion et envisager l’avenir. Celui de pouvoir vendre son deuxième terrain dont le prix lui permettra de soigner le petit Houssein et construire une grande maison qui la mette définitivement à l’abri des regards d’une société dont elle aspire à devenir un membre ordinaire.
Esseh Ould Mousse : Le dernier des damnés
Esseh n’a que vingt trois ans. C’est du moins ce que son maître Mohamed Salem Ould Mouhamadou lui. Vingt trois ans dont dix huit ans de vie d’esclave entre la localité de Lemteyen et une maison de Nouakchott. Son affaire s’est déclenchée en avril dernier, lorsque des organisations de la société civile dénoncent une pratique d’esclavage devant les tribunaux. Confusion. Après enquête, le maître d’Esseh est arrêté et mis en prison. J’ai pris conscience avec ces gens révèle Esseh. Confortablement assis dans le salon de l’un des défenseurs des droits de l’homme, il regarde concentré la télévision afin de rattraper le temps perdu. « Toute ma vie, je la passais quasiment dans la cuisine entre la marmite et la théière. De fête en fête, mes maîtres me donnaient un boubou ou un pantalon. Ce n’est qu’en route vers le commissariat que Mohamed Salem, mon maître m’apprit que je touchais trente mille ouguiyas par mois ». Esseh reconnaît cependant ne jamais avoir été victime de violence de la part de ses maîtres. Sans famille. Sans état civil. Esseh recherche à refaire sa vie. Pour cela, le revoilà de nouveau à Lemteyen pour se faire recenser. Ensuite quoi ? Esseh reconnaît sans détour rien savoir faire que la domesticité. Mais cette fois, libre et rémunéré. Comme sa tante Aichana, Esseh essaie de s’intégrer à sa nouvelle situation d’homme libre, mais psychologiquement affecté, moralement abattu et matériellement démuni. Un combat véritablement inégal contre le destin qu’Esseh, Aichana et tous les autres esclaves mènent, seuls dans un univers particulièrement hostile.
Une indépendance qui ne sert que les esclavagistes
Les histoires d’esclavage en Mauritanie se suivent et se ressemblent. Inexorablement, l’issue de toutes les parodies de procès est la même : L’esclavagiste, quelque soient les preuves qui l’accablent est laissé libre en vertu d’une complaisante liberté provisoire que le juge prononce en sa faveur et la victime délaissée à elle-même pour aller souffrir le martyr quelques parts avec d’hypothétiques parents ou retourner d’où elle vient, faute de structures lui permettant de s’intégrer valablement dans la société. La récente histoire d’El Gawva Mint M’barek dont la fille a retrouvé au marché de Bassiknou son maître contre lequel elle a déposé en 2009 une plainte à la brigade de gendarmerie est éloquente à ce sujet. Isselkha Mint Sidi voulait juste que son ancien maître Sidi Ould Hbabe accepte de lui remettre sa maman Gawva Mint M’barek et ses fils, Sidi Ould El Gawva (8 ans) et Mabrouka Mint El Gawva (10 ans). La gendarmerie de Bassiknou arrête Sidi Ould Hbabe, mais sur intervention d’un influent militaire d’une puissante tribu locale répondant au nom de Sidi Mohamed Ould Ghalla décide de li libérer après s’être engagé de ramener El Gawva et ses deux enfants. Lorsque le procureur de Néma l’apprit, il donna ordre à la gendarmerie de reprendre l’esclavagiste et les victimes et de les acheminer à Néma. Devant lui, El Gawva déclare qu’elle était la propriété du père de Sidi Ould Hbabe qui n’est selon elle que son frère de lait et dont elle use des biens à sa convenance. Visiblement, du n’importe quoi. Des propos que le maître confirme en ajoutant qu’il a demandé à Gawva de le quitter, mais qu’elle a refusé. Le procureur sentant l’éternel montage que les maîtres apprennent à leurs esclaves chaque fois qu’ils sont devant les tribunaux déclare ouvertement à Gawva et à son maître que leurs propos sont faux et complètement fabriqués. Envoyé devant le juge d’instruction, celui-ci a, comme d’habitude dans les affaires d’esclavage décidé de mettre Sidi Ould Hbabe en contrôle judiciaire au niveau de la brigade de Bassiknou et demandé à El Gawva d’aller où elle veut. Du ridicule. Une affaire dans laquelle, le maître et la victime reconnaissent ouvertement des pratiques esclavagistes à travers leur aveu qu’El Gawva était propriétaire du père de Sidi et que celui-ci l’a obtenue en héritage est aussi facilement liquidée en contrôle judiciaire et autres petites combines qui prouvent que la Mauritanie et ses appareils administratifs, de justice et de sécurité se mobilisent pour protéger les esclavagistes au détriment des victimes. En cela déclare Boubacar Messoud tout en colère : « « L’ indépendance » des juges que les pouvoirs publics citent à tout vent ne sert en réalité qu’à assurer l’impunité aux esclavagistes à travers la mise en liberté provisoire de tous les inculpés. Le parquet et le ministère de la justice se cachent derrière cette « indépendance » des juges pour faire échapper des criminels à leurs peines ». Depuis 2007, date de l’adoption de la loi, tous les accusés de pratiques esclavagistes qui se sont présentés devant les tribunaux ont bénéficié de libertés provisoires. Citons à titre d’exemples l’affaire de Zouerate inscrite sous le dossier 21/2013 dans laquelle la cour d’appel de Nouadhibou a tout simplement mis en liberté provisoire M’Hamed Ould Brahim et son fils Mohamed Salem, malgré les preuves accablantes retenues contre eux de mise en esclavage pendant plusieurs années de Shoueida et ses neuf enfants. L’affaire du jeune Esseh Ould Messe (23 ans), dossier 374/2013 mettant en cause Mohamed Salem Ould Mouhamedou qui a été tout aussi mis en liberté provisoire. L’affaire 252/2011 dite affaire de Nouadhibou, la mise en cause Riv’a Mint Mohamed Hassoune a tout simplement été mise en liberté provisoire avec évocation par le juge de justifications fallacieuses. L’affaire Oumoulkhair Mint Yarbe et fils mettant en cause l’ancien colonel Viyah Ould Maayouf qui n’a même pas été convoqué par la justice. Le dossier 501/2011 communément connu sous le nom affaire Yarg et Saïd dans lequel l’esclavagiste Ahmed Ould Hassine qui, au lieu d’écoper des cinq ans et dix millions d’ouguiyas prévues par la loi n’a été condamné qu’à deux ans et deux cent mille ouguiyas avant d’être mis en liberté provisoire depuis un an six mois. L’affaire Rahma Mint Legreivi ; dossier 179/2013 dans lequel la mise en cause a bénéficié d’une liberté provisoire. Selon certains exégètes du droit, spécialistes de l’interprétation tendancieuse des lois, la constitution du délit d’esclavage est axée fondamentalement sur la démonstration de l’existence d’un travail forcé non rémunéré. Visiblement les faits avérés, la reconnaissance et la flagrance des transgressions ne valent plus. Sinon comment un juge de Néma devant lequel un présumé esclave a reconnu que ces personnes sont ses esclaves hérités de son père, peut il ensuite lui accorder une liberté provisoire au motif d’être un bienfaiteur puisque l’un des enfants esclaves récite la Fatiha où que les autres dressés pour servir le maître pleurent en apprenant que celui-ci ira en prison ? L’attitude des juges en faveur des esclavagistes est normale eu égard que le Président par le déni de l’esclavage au moins par deux fois semble être le premier défenseur de ces esclavagistes. Dans un pays comme la Mauritanie, les faits, propos et gestes du chef constituent une source d’inspiration à tous les autres démembrements de l’Etat. Le zèle aidant, certains percevront ces attitudes comme des signaux forts pour faire ou ne pas faire quitte à tordre copieusement et continuellement le cou des lois et des conventions. Le refus incompréhensible aux sociétés des droits de l’homme spécialisées à pouvoir se constituer en partie civile dans les affaires d’esclavage n’est qu’une autre manifestation de cette absence de volonté réelle d’éradiquer ce phénomène. La confiscation de cette partie civile et son assujettissement à une institution dépendant de l’exécutif est une autre preuve on ne peut plus éloquente de contrôler effectivement la question de la gestion de la problématique de l’esclavage.
Une loi pleine d’insuffisances
Depuis son adoption en 2007, la loi 0048/2007 qui criminalise l’abject phénomène de l’esclavage n’a quasiment jamais fait l’objet d’une véritable mise en œuvre afin qu’elle permette comme ça devrait être le cas de remettre les victimes dans leurs droits et de punir les nombreux contrevenants. Les responsabilités de ces réticences inacceptables et injustifiées sont essentiellement du côté des pouvoirs publics dont les démembrements jouent un grand rôle dans la protection délibérée des esclavagistes. La manière avec laquelle plusieurs dizaines de dossiers ont été gérés prouve l’inapplication de la loi d’une part et le manque de volonté d’autre part. Les différents arrêts prononcés par les tribunaux statuant sur les cas de pratiques esclavagistes souvent avérées démontrent de jour en jour la prééminence de l’impunité aux esclavagistes sur la justice en faveur des victimes. La profusion des libertés provisoires synonyme de liberté tout court est une preuve éloquente de ce regrettable constat. Quand un juge prononce une liberté provisoire pour un esclavagiste de Bassiknou ou de Zouerate, ce n’est qu’une manière subtile de lui dire d’aller se la couler douce quelque part au Sahara ou au Mali et à la victime d’aller se faire voir ailleurs. La prononciation de la liberté provisoire est quasiment systématique dans les tribunaux mauritaniens dans les affaires liées à l’esclavage. Sur la dizaine de cas cités devant eux, aucun esclavagiste n’a fait au delà de deux ou trois mois de détention effective. Pire, les libérations sont prononcées en l’absence et des victimes et de leurs avocats. Ce qui constitue une violation flagrante du principe du contradictoire pourtant clairement garanti par le code de procédure pénale. La lutte contre l’impunité implique une ferme volonté et une grande foi à propager la justice entre les hommes. Cette lutte entraîne inévitablement le droit de savoir et celui de justice et de réparation pour les victimes. Or, il s’avère que tous les pouvoirs qui se sont succédés en Mauritanie ont tous choisi de faire fi de la justice et de la mettre sous le boisseau à travers la protection des esclavagistes , la dénégation des faits et la non prise en compte des droits des victimes. Le moins qu’on puisse dire est que cela démontre une absence notoire d’une quelconque volonté politique. Dans un pays comme la Mauritanie, quand la première autorité nationale nie publiquement un phénomène dont sont victimes plusieurs centaines de milliers de citoyens, il est difficile de s’attendre à ce que les autres secteurs chargés de dire le droit ne soient pas en phase avec cette autorité suprême à travers les agissements et les arrêts judiciaires dont la teneur reflète la position officielle sur la question mise en cause. Plus de six ans après son adoption, la loi 0048/2007 souffre encore d’inapplication et de réticence dans la mise en œuvre. La dernière affaire de Zouerate où toute une famille : Une mère Shoueida et ses neuf enfants étaient détenus en esclavage par M’Hamed Ould Brahim et son fils Mohamed Salem Ould Brahim est une preuve éloquente de cette mauvaise volonté.
Liberté provisoire : La grande imposture
Depuis son adoption en 2007, la loi 0048/2007 n’a été mise en œuvre que quelques rares fois par les tribunaux nationaux. Chaque fois, en complicité avec les victimes ou leurs parents, les autorités de la justice requalifiaient des faits d’esclavages parfois avérés en travail de mineur ou exploitation injustifiée de personne. Les rares fois où les juges ont conclu souvent à contre cœur à pratiques esclavagistes et accepté d’envoyer les coupables en prison, les procédures de remise en liberté se mettaient systématiquement en branle à travers libertés provisoires complaisamment accordées ou contrôles judiciaires lapidairement prononcés. Une manière toute originale de permettre aux victimes de crimes aussi graves de disparaître.
1. Affaire de Zouerate : Madame Shoueida et ses neufs enfants mis en esclavage suivant les aveux mêmes de leurs maîtres M’Hamed Ould Brahim et son fils Mohamed Salem qui ont reconnu devant le juge qu’ils ont hérité de cette famille. Le 21 avril 2013, la Cour pénale de Nouadhibou près cour d’appel de Nouadhibou rend public l’arrêt N0 07/2013 dans l’affaire 21/2013 mettant en liberté provisoire les deux esclavagistes auteurs de faits avérés conformément aux articles 4 et 7 de la loi 0048/2007.
2. Affaire Esse Ould Messe : Le dossier 374/2013 dans l’affaire d jeune Esse Ould Messe (23 ans) mis en esclavage par le sieur Mohamed Salem Ould Mouhamadou dans une maison de Nouakchott. Après un lapidaire examen, le mis en cause a tout simplement été mis en liberté provisoire.
3. Affaire de Nouadhibou : C’est le dossier 252/2011 qui met en cause Rivaa Mint Mohamed Hassoune. Malgré la confirmation des faits pour lesquels elle a été inculpée par toutes les juridictions, notamment pratiques esclavagistes sur des filles, Rivaa a bénéficié d’une liberté provisoire sur la base d’arguments fallacieux avancés par la cause dont à titre d’exemple l’absence de prison pour femme à Nouadhibou. Or, que de fois des femmes ont été acheminées de Néma à plus de mille kilomètres pour être emprisonnées à Nouakchott.
4. Affaire Oumoulkhair Mint Yarba et fils : Dossier…/… encore pendant devant la justice sans que le mis en cause, l’ancien colonel Viyah Ould Maayouf ne soit inquiété outre mesure. Pendant que la victime Oumoulkhair et ses enfants trainent les douleurs psychologiques consécutives aux pratiques inhumaines et immorales que Viyah leur a fait subir, celui-ci se pavane impunément au vu et au su de toutes les juridictions nationales. Un exemple flagrant de complicité, d’impunité et d’injustice.
5. Affaire Yarg et Saïd : Dossier 501 communément appelé Affaire Yarg et Saïd qui met en cause le sieur Ahmed Ould Hassine pour pratiques esclavagistes sur mineurs. Les tribunaux accablent l’inculpé et lui insurgent une peine minimale de deux ans d’emprisonnement assortie d’une amende de 200.000 UM, alors que la loi prévoit 5 à 10 ans d’emprisonnement et 5 millions d’amende. Vraiment, une peine insignifiante pour un crime qui vient d’être élevé à crime contre l’humanité en vertu des derniers amendements constitutionnels issus du dialogue du 9 septembre au 19 octobre 2011 entre la majorité présidentielle et quatre partis de l’opposition. Mieux, Ahmed Ould Hassine, le bourreau de Yarg et Saïd ne purgera que quelques mois avant de bénéficier encore une fois de liberté provisoire.
6. Affaire Rahma Mint Legreyvi : Objet du dossier 179/2013 qui met en cause la dame Rahma Mint Legreyvi pour pratiques esclavagistes sur une fille mineure.
7. Affaire El Gawva Mint M’barek : Dont le maître Sidi Ould Hbabe a été retrouvée par Isselkha Mint Saghir, la fille d’El Gawva au camp de M’berra. Devant le juge, Sidi Ould Hbabe reconnaît qu’El Gawva était la propriété de son père. Ce que séance tenante El Gawva confirme. Malgré cela, le juge met l’esclavagiste sous contrôle judiciaire. Simplement.
Volonté manifeste de protéger continuellement les esclavagistes au détriment des victimes sur fond de pressions tribale et régionale et de mauvaise foi des juges. Plusieurs autres dossiers sont pendants devant les juridictions nationales à travers tout le pays, notamment au Hodh Chargui où le brûlant dossier des sœurs venant de Nbeiket Lahwach ou celui de celles venant de Bassiknou. L’affaire de l’esclave El Gawva dont la fille a reconnu le maître au camp des réfugiés de Mberra défraie encore la chronique et démontre la manière avec laquelle certaines autorités administratives, sécuritaires et judiciaires gèrent encore les dossiers liés à la question de l’esclavage. Les familles morcelées dont une partie souffre encore le martyr avec les familles de maîtres est une manifestation on ne peut plus claire de l’impunité, du manque de sérieux dans le traitement de la question et de la timidité à la prendre à bras le corps.
Références citées : L’ordonnance militaire et la loi 0048/2008 + Autres textes ayant rapport avec la question.
constitue un tournant, malgré ses nombreuses insuffisances. L’action des anciens esclaves eux-mêmes a fortement contribué à secouer le cocotier. Déjà en 1978, naissance du premier mouvement qui plaide pour la promotion des Harratines. L’engagement très intense des organisations de la société civile, notamment SOS Esclaves créée en 1995 et qui n’a été reconnue qu’en 2005, juste à quelques mois de la chute du Président Maouiya Ould Sid’ Ahmed Taya. Les nouvelles exigences de la Communauté internationale qui conditionne certains de ses rapports à la manière avec laquelle les pays prennent en compte la problématique des droits de l’homme. Malgré tout ça, la question de l’esclavage divise. Le pouvoir et ses cercles administratifs, sécuritaires, politiques et judiciaires ne veulent entendre parler que de séquelles. Alors que certaines organisations des droits de l’homme assurent l’existence de pratiques esclavagistes sur l’ensemble du territoire national. Combien d’esclaves ? Impossible de savoir. En dehors de quelques chiffres fantaisistes, aucune statistique officielle ne permet de mesurer l’ampleur réelle du phénomène. Le 29 avril 2013, le Manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Harratines recommandait le lancement d’une enquête quantitative et qualitative pour mesurer le phénomène en termes de pratiques, de survivances et de séquelles. Enquête.
Aichana Mint Ebeid : Une victime qui se meurt
Quelques parts, comme si elle voulait se faire oublier, échapper aux regards inquisiteurs des autres, Aichana Mint Ebeid, l’une des premières victimes de l’esclavage que SOS Esclaves a pu extraire en 1996 au calvaire de la servitude nous accueille avec une certaine méfiance et un brin de lassitude et de désespoir. Son histoire, elle l’a maintes fois ressassée au point que ses filles devenues grandes ne supportent plus qu’elles en parlent. Heureusement, aujourd’hui, elles ne sont pas là. Dans sa modeste chambre où un téléviseur rebelle refuse de s’allumer Aichana nous apprend qu’elle ne travaille plus depuis plusieurs mois à cause de la maladie de son benjamin El Houssein (13 ans) qu’un mal qu’aucune analyse ni aucun marabout n’a pu détecter selon les propos d’Aichana. Je vis dit –elle grâce à la bonté d’Allah et du soutien de quelques bonnes volontés. Lorsqu’elle évoque ses randonnées entre Tambaz et Lemteyen pour être au service de ses maîtres, les Ehl Mouhamadou et les Ehl Moissa, tantôt dans les rizières ou comme domestique bonne à tout faire suivant le système de « Teywil » qui consiste à ce que deux familles de maîtres se partagent la force de travail d’un seul esclave. Lorsqu’en 1996 elle sollicite l’aide de SOS Esclaves encore non reconnue, Aichana ne savait pas qu’il lui faudrait beaucoup de tracasseries pour pouvoir récupérer ses enfants restés chez ses maîtres dans les confins du Trarza. Une affaire dont parla à l’époque la chaîne de télévision FR3 et qui valut à Boubacar Ould Messaoud, Me Brahim Ould Ebetty, Me Fatimata M’baye et le Professeur Cheikh Saad Bouh Kamara un séjour en prison pour administration d’organisation non reconnue pour certains d’entre eux et autres arguments fallacieux pour d’autres. Dix sept ans après sa libération, Aichana lutte encore pour son émancipation. Ses enfants n’ont pas encore d’état civil. Sa vie dépend encore de son labeur et de son engagement. Esquissant un sourire évocateur, Aichana ne se rappelle plus exactement des détails de son histoire. Mais elle est sûre que ce n’était pas une sinécure. C’était un infernal enfer d’un travail continu et de régulières violences pour la moindre insatisfaction. Entre deux mots, Aichana à peine la quarantaine préfère détourner la discussion et envisager l’avenir. Celui de pouvoir vendre son deuxième terrain dont le prix lui permettra de soigner le petit Houssein et construire une grande maison qui la mette définitivement à l’abri des regards d’une société dont elle aspire à devenir un membre ordinaire.
Esseh Ould Mousse : Le dernier des damnés
Esseh n’a que vingt trois ans. C’est du moins ce que son maître Mohamed Salem Ould Mouhamadou lui. Vingt trois ans dont dix huit ans de vie d’esclave entre la localité de Lemteyen et une maison de Nouakchott. Son affaire s’est déclenchée en avril dernier, lorsque des organisations de la société civile dénoncent une pratique d’esclavage devant les tribunaux. Confusion. Après enquête, le maître d’Esseh est arrêté et mis en prison. J’ai pris conscience avec ces gens révèle Esseh. Confortablement assis dans le salon de l’un des défenseurs des droits de l’homme, il regarde concentré la télévision afin de rattraper le temps perdu. « Toute ma vie, je la passais quasiment dans la cuisine entre la marmite et la théière. De fête en fête, mes maîtres me donnaient un boubou ou un pantalon. Ce n’est qu’en route vers le commissariat que Mohamed Salem, mon maître m’apprit que je touchais trente mille ouguiyas par mois ». Esseh reconnaît cependant ne jamais avoir été victime de violence de la part de ses maîtres. Sans famille. Sans état civil. Esseh recherche à refaire sa vie. Pour cela, le revoilà de nouveau à Lemteyen pour se faire recenser. Ensuite quoi ? Esseh reconnaît sans détour rien savoir faire que la domesticité. Mais cette fois, libre et rémunéré. Comme sa tante Aichana, Esseh essaie de s’intégrer à sa nouvelle situation d’homme libre, mais psychologiquement affecté, moralement abattu et matériellement démuni. Un combat véritablement inégal contre le destin qu’Esseh, Aichana et tous les autres esclaves mènent, seuls dans un univers particulièrement hostile.
Une indépendance qui ne sert que les esclavagistes
Les histoires d’esclavage en Mauritanie se suivent et se ressemblent. Inexorablement, l’issue de toutes les parodies de procès est la même : L’esclavagiste, quelque soient les preuves qui l’accablent est laissé libre en vertu d’une complaisante liberté provisoire que le juge prononce en sa faveur et la victime délaissée à elle-même pour aller souffrir le martyr quelques parts avec d’hypothétiques parents ou retourner d’où elle vient, faute de structures lui permettant de s’intégrer valablement dans la société. La récente histoire d’El Gawva Mint M’barek dont la fille a retrouvé au marché de Bassiknou son maître contre lequel elle a déposé en 2009 une plainte à la brigade de gendarmerie est éloquente à ce sujet. Isselkha Mint Sidi voulait juste que son ancien maître Sidi Ould Hbabe accepte de lui remettre sa maman Gawva Mint M’barek et ses fils, Sidi Ould El Gawva (8 ans) et Mabrouka Mint El Gawva (10 ans). La gendarmerie de Bassiknou arrête Sidi Ould Hbabe, mais sur intervention d’un influent militaire d’une puissante tribu locale répondant au nom de Sidi Mohamed Ould Ghalla décide de li libérer après s’être engagé de ramener El Gawva et ses deux enfants. Lorsque le procureur de Néma l’apprit, il donna ordre à la gendarmerie de reprendre l’esclavagiste et les victimes et de les acheminer à Néma. Devant lui, El Gawva déclare qu’elle était la propriété du père de Sidi Ould Hbabe qui n’est selon elle que son frère de lait et dont elle use des biens à sa convenance. Visiblement, du n’importe quoi. Des propos que le maître confirme en ajoutant qu’il a demandé à Gawva de le quitter, mais qu’elle a refusé. Le procureur sentant l’éternel montage que les maîtres apprennent à leurs esclaves chaque fois qu’ils sont devant les tribunaux déclare ouvertement à Gawva et à son maître que leurs propos sont faux et complètement fabriqués. Envoyé devant le juge d’instruction, celui-ci a, comme d’habitude dans les affaires d’esclavage décidé de mettre Sidi Ould Hbabe en contrôle judiciaire au niveau de la brigade de Bassiknou et demandé à El Gawva d’aller où elle veut. Du ridicule. Une affaire dans laquelle, le maître et la victime reconnaissent ouvertement des pratiques esclavagistes à travers leur aveu qu’El Gawva était propriétaire du père de Sidi et que celui-ci l’a obtenue en héritage est aussi facilement liquidée en contrôle judiciaire et autres petites combines qui prouvent que la Mauritanie et ses appareils administratifs, de justice et de sécurité se mobilisent pour protéger les esclavagistes au détriment des victimes. En cela déclare Boubacar Messoud tout en colère : « « L’ indépendance » des juges que les pouvoirs publics citent à tout vent ne sert en réalité qu’à assurer l’impunité aux esclavagistes à travers la mise en liberté provisoire de tous les inculpés. Le parquet et le ministère de la justice se cachent derrière cette « indépendance » des juges pour faire échapper des criminels à leurs peines ». Depuis 2007, date de l’adoption de la loi, tous les accusés de pratiques esclavagistes qui se sont présentés devant les tribunaux ont bénéficié de libertés provisoires. Citons à titre d’exemples l’affaire de Zouerate inscrite sous le dossier 21/2013 dans laquelle la cour d’appel de Nouadhibou a tout simplement mis en liberté provisoire M’Hamed Ould Brahim et son fils Mohamed Salem, malgré les preuves accablantes retenues contre eux de mise en esclavage pendant plusieurs années de Shoueida et ses neuf enfants. L’affaire du jeune Esseh Ould Messe (23 ans), dossier 374/2013 mettant en cause Mohamed Salem Ould Mouhamedou qui a été tout aussi mis en liberté provisoire. L’affaire 252/2011 dite affaire de Nouadhibou, la mise en cause Riv’a Mint Mohamed Hassoune a tout simplement été mise en liberté provisoire avec évocation par le juge de justifications fallacieuses. L’affaire Oumoulkhair Mint Yarbe et fils mettant en cause l’ancien colonel Viyah Ould Maayouf qui n’a même pas été convoqué par la justice. Le dossier 501/2011 communément connu sous le nom affaire Yarg et Saïd dans lequel l’esclavagiste Ahmed Ould Hassine qui, au lieu d’écoper des cinq ans et dix millions d’ouguiyas prévues par la loi n’a été condamné qu’à deux ans et deux cent mille ouguiyas avant d’être mis en liberté provisoire depuis un an six mois. L’affaire Rahma Mint Legreivi ; dossier 179/2013 dans lequel la mise en cause a bénéficié d’une liberté provisoire. Selon certains exégètes du droit, spécialistes de l’interprétation tendancieuse des lois, la constitution du délit d’esclavage est axée fondamentalement sur la démonstration de l’existence d’un travail forcé non rémunéré. Visiblement les faits avérés, la reconnaissance et la flagrance des transgressions ne valent plus. Sinon comment un juge de Néma devant lequel un présumé esclave a reconnu que ces personnes sont ses esclaves hérités de son père, peut il ensuite lui accorder une liberté provisoire au motif d’être un bienfaiteur puisque l’un des enfants esclaves récite la Fatiha où que les autres dressés pour servir le maître pleurent en apprenant que celui-ci ira en prison ? L’attitude des juges en faveur des esclavagistes est normale eu égard que le Président par le déni de l’esclavage au moins par deux fois semble être le premier défenseur de ces esclavagistes. Dans un pays comme la Mauritanie, les faits, propos et gestes du chef constituent une source d’inspiration à tous les autres démembrements de l’Etat. Le zèle aidant, certains percevront ces attitudes comme des signaux forts pour faire ou ne pas faire quitte à tordre copieusement et continuellement le cou des lois et des conventions. Le refus incompréhensible aux sociétés des droits de l’homme spécialisées à pouvoir se constituer en partie civile dans les affaires d’esclavage n’est qu’une autre manifestation de cette absence de volonté réelle d’éradiquer ce phénomène. La confiscation de cette partie civile et son assujettissement à une institution dépendant de l’exécutif est une autre preuve on ne peut plus éloquente de contrôler effectivement la question de la gestion de la problématique de l’esclavage.
Une loi pleine d’insuffisances
Depuis son adoption en 2007, la loi 0048/2007 qui criminalise l’abject phénomène de l’esclavage n’a quasiment jamais fait l’objet d’une véritable mise en œuvre afin qu’elle permette comme ça devrait être le cas de remettre les victimes dans leurs droits et de punir les nombreux contrevenants. Les responsabilités de ces réticences inacceptables et injustifiées sont essentiellement du côté des pouvoirs publics dont les démembrements jouent un grand rôle dans la protection délibérée des esclavagistes. La manière avec laquelle plusieurs dizaines de dossiers ont été gérés prouve l’inapplication de la loi d’une part et le manque de volonté d’autre part. Les différents arrêts prononcés par les tribunaux statuant sur les cas de pratiques esclavagistes souvent avérées démontrent de jour en jour la prééminence de l’impunité aux esclavagistes sur la justice en faveur des victimes. La profusion des libertés provisoires synonyme de liberté tout court est une preuve éloquente de ce regrettable constat. Quand un juge prononce une liberté provisoire pour un esclavagiste de Bassiknou ou de Zouerate, ce n’est qu’une manière subtile de lui dire d’aller se la couler douce quelque part au Sahara ou au Mali et à la victime d’aller se faire voir ailleurs. La prononciation de la liberté provisoire est quasiment systématique dans les tribunaux mauritaniens dans les affaires liées à l’esclavage. Sur la dizaine de cas cités devant eux, aucun esclavagiste n’a fait au delà de deux ou trois mois de détention effective. Pire, les libérations sont prononcées en l’absence et des victimes et de leurs avocats. Ce qui constitue une violation flagrante du principe du contradictoire pourtant clairement garanti par le code de procédure pénale. La lutte contre l’impunité implique une ferme volonté et une grande foi à propager la justice entre les hommes. Cette lutte entraîne inévitablement le droit de savoir et celui de justice et de réparation pour les victimes. Or, il s’avère que tous les pouvoirs qui se sont succédés en Mauritanie ont tous choisi de faire fi de la justice et de la mettre sous le boisseau à travers la protection des esclavagistes , la dénégation des faits et la non prise en compte des droits des victimes. Le moins qu’on puisse dire est que cela démontre une absence notoire d’une quelconque volonté politique. Dans un pays comme la Mauritanie, quand la première autorité nationale nie publiquement un phénomène dont sont victimes plusieurs centaines de milliers de citoyens, il est difficile de s’attendre à ce que les autres secteurs chargés de dire le droit ne soient pas en phase avec cette autorité suprême à travers les agissements et les arrêts judiciaires dont la teneur reflète la position officielle sur la question mise en cause. Plus de six ans après son adoption, la loi 0048/2007 souffre encore d’inapplication et de réticence dans la mise en œuvre. La dernière affaire de Zouerate où toute une famille : Une mère Shoueida et ses neuf enfants étaient détenus en esclavage par M’Hamed Ould Brahim et son fils Mohamed Salem Ould Brahim est une preuve éloquente de cette mauvaise volonté.
Liberté provisoire : La grande imposture
Depuis son adoption en 2007, la loi 0048/2007 n’a été mise en œuvre que quelques rares fois par les tribunaux nationaux. Chaque fois, en complicité avec les victimes ou leurs parents, les autorités de la justice requalifiaient des faits d’esclavages parfois avérés en travail de mineur ou exploitation injustifiée de personne. Les rares fois où les juges ont conclu souvent à contre cœur à pratiques esclavagistes et accepté d’envoyer les coupables en prison, les procédures de remise en liberté se mettaient systématiquement en branle à travers libertés provisoires complaisamment accordées ou contrôles judiciaires lapidairement prononcés. Une manière toute originale de permettre aux victimes de crimes aussi graves de disparaître.
1. Affaire de Zouerate : Madame Shoueida et ses neufs enfants mis en esclavage suivant les aveux mêmes de leurs maîtres M’Hamed Ould Brahim et son fils Mohamed Salem qui ont reconnu devant le juge qu’ils ont hérité de cette famille. Le 21 avril 2013, la Cour pénale de Nouadhibou près cour d’appel de Nouadhibou rend public l’arrêt N0 07/2013 dans l’affaire 21/2013 mettant en liberté provisoire les deux esclavagistes auteurs de faits avérés conformément aux articles 4 et 7 de la loi 0048/2007.
2. Affaire Esse Ould Messe : Le dossier 374/2013 dans l’affaire d jeune Esse Ould Messe (23 ans) mis en esclavage par le sieur Mohamed Salem Ould Mouhamadou dans une maison de Nouakchott. Après un lapidaire examen, le mis en cause a tout simplement été mis en liberté provisoire.
3. Affaire de Nouadhibou : C’est le dossier 252/2011 qui met en cause Rivaa Mint Mohamed Hassoune. Malgré la confirmation des faits pour lesquels elle a été inculpée par toutes les juridictions, notamment pratiques esclavagistes sur des filles, Rivaa a bénéficié d’une liberté provisoire sur la base d’arguments fallacieux avancés par la cause dont à titre d’exemple l’absence de prison pour femme à Nouadhibou. Or, que de fois des femmes ont été acheminées de Néma à plus de mille kilomètres pour être emprisonnées à Nouakchott.
4. Affaire Oumoulkhair Mint Yarba et fils : Dossier…/… encore pendant devant la justice sans que le mis en cause, l’ancien colonel Viyah Ould Maayouf ne soit inquiété outre mesure. Pendant que la victime Oumoulkhair et ses enfants trainent les douleurs psychologiques consécutives aux pratiques inhumaines et immorales que Viyah leur a fait subir, celui-ci se pavane impunément au vu et au su de toutes les juridictions nationales. Un exemple flagrant de complicité, d’impunité et d’injustice.
5. Affaire Yarg et Saïd : Dossier 501 communément appelé Affaire Yarg et Saïd qui met en cause le sieur Ahmed Ould Hassine pour pratiques esclavagistes sur mineurs. Les tribunaux accablent l’inculpé et lui insurgent une peine minimale de deux ans d’emprisonnement assortie d’une amende de 200.000 UM, alors que la loi prévoit 5 à 10 ans d’emprisonnement et 5 millions d’amende. Vraiment, une peine insignifiante pour un crime qui vient d’être élevé à crime contre l’humanité en vertu des derniers amendements constitutionnels issus du dialogue du 9 septembre au 19 octobre 2011 entre la majorité présidentielle et quatre partis de l’opposition. Mieux, Ahmed Ould Hassine, le bourreau de Yarg et Saïd ne purgera que quelques mois avant de bénéficier encore une fois de liberté provisoire.
6. Affaire Rahma Mint Legreyvi : Objet du dossier 179/2013 qui met en cause la dame Rahma Mint Legreyvi pour pratiques esclavagistes sur une fille mineure.
7. Affaire El Gawva Mint M’barek : Dont le maître Sidi Ould Hbabe a été retrouvée par Isselkha Mint Saghir, la fille d’El Gawva au camp de M’berra. Devant le juge, Sidi Ould Hbabe reconnaît qu’El Gawva était la propriété de son père. Ce que séance tenante El Gawva confirme. Malgré cela, le juge met l’esclavagiste sous contrôle judiciaire. Simplement.
Volonté manifeste de protéger continuellement les esclavagistes au détriment des victimes sur fond de pressions tribale et régionale et de mauvaise foi des juges. Plusieurs autres dossiers sont pendants devant les juridictions nationales à travers tout le pays, notamment au Hodh Chargui où le brûlant dossier des sœurs venant de Nbeiket Lahwach ou celui de celles venant de Bassiknou. L’affaire de l’esclave El Gawva dont la fille a reconnu le maître au camp des réfugiés de Mberra défraie encore la chronique et démontre la manière avec laquelle certaines autorités administratives, sécuritaires et judiciaires gèrent encore les dossiers liés à la question de l’esclavage. Les familles morcelées dont une partie souffre encore le martyr avec les familles de maîtres est une manifestation on ne peut plus claire de l’impunité, du manque de sérieux dans le traitement de la question et de la timidité à la prendre à bras le corps.
Références citées : L’ordonnance militaire et la loi 0048/2008 + Autres textes ayant rapport avec la question.

 Actualités
Actualités



















